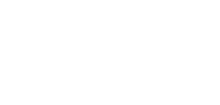Bonjour à tous,
Aujourd'hui, comme je suis en grande forme, j'ai pris mes petits doigts et mon clavier pour vous taper des extraits (euh, en fait, non, non, ce ne sont pas des extraits, désolée) d'une introduction d'Orson Scott Card, que j'ai trouvé, ma foi, passionnante et édifiante. :love:
Le tout, assorti bien sûr d'un petit sondage, pour savoir ce que vous pensez des films ou livres d'horreur, de terreur ou d'angoisse. Comment regardez-vous ce genre de films, qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
Et surtout, comment vous expliquez-vous, cette attirance pour la peur (en-dehors des raisons biologiques, l'adrénaline, tout ça) ?
Voilà, je vous laisse donc en compagnie d'Orson Scott Card, et je vous souhaite une bonne lecture !
Je suis incapable de regarder un film dhorreur ou de suspense au cinéma. Jai essayé, mais langoisse devient vite trop forte ; lécran est trop grand, les personnages trop réels. Au bout dun moment, je dois quitter mon fauteuil et rentrer chez moi : je nen peux plus.
Et vous savez où je les regarde, finalement, ces films-là ? Chez moi, sur le câble. La petite lucarne est beaucoup plus rassurante, placée au milieu de mon environnement familier ; et quand ça devient trop insupportable, je peux toujours zapper sur une rediffusion de La Petite Maison dans la Prairie ou dun navet absolu des années 30, en attendant de me calmer et de revenir voir comment la situation a évolué.
Ca sest passé comme ça pour Alien et Terminator : je ne les ai jamais vus dun bout à lautre. Je me rends bien compte quen réagissant ainsi je pervertis le dessein du réalisateur, qui est une narration linéaire ; mais, avec ma télécommande, regarder la télévision est devenu un art participatif : je puis désormais effectuer un redécoupage des films que je juge trop angoissants. Pour moi, LArme fatale est beaucoup plus agréable entrelardé dextraits des Nuits Blanches dIbiza et des Animaux du Monde.
Ces remarques nous amènent à parler de linstrument le plus puissant dont disposent les raconteurs dhistoires : la peur. Et pas seulement la peur, mais langoisse. Des trois formes de la peur, langoisse est la première et la plus forte : cest cette tension, cette attente qui naît quand on sait quil y a quelque chose à craindre mais quon na pas encore réussi à identifier lobjet de cette crainte ; cest la peur qui naît quand on saperçoit soudain que son épouse devrait être rentrée depuis une heure, quand on entend un bruit bizarre dans la chambre du petit dernier, quand on se rend compte quune fenêtre quon est certain davoir fermée est à présent ouverte, que les rideaux bougent, et quon est seul dans la maison.
La terreur, elle, nintervient quà linstant où lon voit ce dont on a peur : lintrus qui savance armé dun poignard, les phares de la voiture qui remonte lallée de la maison, les hommes du Ku Klux Klan qui sortent des buissons, lun deux une corde à la main. Cest linstant où tous les muscles du corps se crispent et se tétanisent, ou bien où lon se met à hurler, ou encore où lon senfuit. Il y a de la folie dans cet instant, une force paroxystique mais cest une force de déchaînement, pas de tension, et, de ce point de vue, la terreur, si éprouvante soit-elle, est préférable à linquiétude : enfin, on connaît au moins lapparence de ce que lon craint. On en connaît les limites, les dimensions. On sait à quoi sattendre.
Lhorreur est la plus faible des trois. Après que lévénement redouté sest produit, on en contemple les restes, les vestiges, le cadavre affreusement mutilé ; les émotions vont du dégoût à la compassion envers la victime, et même la pitié se teinte de révulsion et de répugnance ; on en vient à rejeter la scène et à nier toute lhumanité au corps quon nous montre ; par la répétition, lhorreur perd sa capacité à émouvoir, déshumanise jusquà un certaint point la victime, et, par conséquent, le spectateur. Comme lont appris les Sonderkommandos des camps de la mort, quand on a déplacé un certain nombre de cadavres nus, on na plus envie de pleurer ni de vomir : on fait le boulot, un point cest tout. On a cessé de les considérer comme des individus.
Cest pourquoi je mattriste de voir que tant dauteurs contemporains dhistoires dépouvante sintéressent presque exclusivement à lhorreur et délaissent linquiétude. Les films gore ne prennent plus la peine dinspirer au spectateur de la sympathie pour les personnages, ce qui est pourtant la clé pour le plonger dans linquiétude. Les scènes de terreur ne sont plus terrifiantes grâce à lempathie que lon ressent pour la victime, mais fascinantes parce que le public a envie de voir quelle méthode inventive de massacre le scénariste et le réalisateur ont mise au point. Oh, la victime transformée en chiche-kebab ! Ah, génial, le monstre qui fait jaillir les yeux du type de lintérieur !
Obsédés par le désir de filmer linfilmable, les réalisateurs dhorreur montrent linnommable au kilomètre et déshumanisent dans le même temps leur public en faisant de la souffrance humaine un « divertissement » soumis à une escalade obscène. Cest déjà grave, mais, à mon grand regret, trop décrivains de terreur font de même ; ils nont pas retenu la vraie leçon du succès de Stephen King : ce ne sont pas les passages gore qui font lefficacité de ses livres, cest la sympathie quil inspire au lecteur pour ses personnages avant le déclenchement des épisodes dhorreur, et ses meilleures uvres sont celles où, comme dans Dead Zone ou Le Fléau, lhorreur est relativement réduite. Ces récits baignent plutôt dans une inquiétude qui mène aux instants cathartiques de terreur et de souffrance, et, plus important, la douleur que vivent les personnages a un sens.
Cest tout lart de langoisse : faire si bien percevoir un personnage quon en vient à redouter ce quil redoute et pour les mêmes motifs que lui. Le lecteur ne reste pas extérieur à lui, à le regarder se faire recouvrir dune bave sanglante ou à contempler ses blessures béantes : il est aspiré à lintérieur, où il tremble à lavance de ce qui va se produire ou de ce qui risque de se passer. Nimporte qui peut débiter un cadavre en morceaux dans un roman ; seul un écrivain peut inspirer au lecteur le désir que le personnage survive.
Donc je nécris pas dhistoires dhorreur. Cest vrai, il arrive à mes personnages des évènements désagréables, voire terribles, mais je ne vous les montre pas en Technicolor. Je nen ai pas besoin et je nen ai pas envie parce que, pris par langoisse, vous imaginerez bien pire que tout ce que je pourrais inventer.
Orson Scott Card, introduction à LHomme transformé, récits dangoisse.
J'espère que la longueur du texte ne vous aura pas découragés, désolée, je voulais faire quelques coupes, mais je n'ai pas réussi à m'y résoudre.
Aujourd'hui, comme je suis en grande forme, j'ai pris mes petits doigts et mon clavier pour vous taper des extraits (euh, en fait, non, non, ce ne sont pas des extraits, désolée) d'une introduction d'Orson Scott Card, que j'ai trouvé, ma foi, passionnante et édifiante. :love:
Le tout, assorti bien sûr d'un petit sondage, pour savoir ce que vous pensez des films ou livres d'horreur, de terreur ou d'angoisse. Comment regardez-vous ce genre de films, qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
Et surtout, comment vous expliquez-vous, cette attirance pour la peur (en-dehors des raisons biologiques, l'adrénaline, tout ça) ?
Voilà, je vous laisse donc en compagnie d'Orson Scott Card, et je vous souhaite une bonne lecture !
Je suis incapable de regarder un film dhorreur ou de suspense au cinéma. Jai essayé, mais langoisse devient vite trop forte ; lécran est trop grand, les personnages trop réels. Au bout dun moment, je dois quitter mon fauteuil et rentrer chez moi : je nen peux plus.
Et vous savez où je les regarde, finalement, ces films-là ? Chez moi, sur le câble. La petite lucarne est beaucoup plus rassurante, placée au milieu de mon environnement familier ; et quand ça devient trop insupportable, je peux toujours zapper sur une rediffusion de La Petite Maison dans la Prairie ou dun navet absolu des années 30, en attendant de me calmer et de revenir voir comment la situation a évolué.
Ca sest passé comme ça pour Alien et Terminator : je ne les ai jamais vus dun bout à lautre. Je me rends bien compte quen réagissant ainsi je pervertis le dessein du réalisateur, qui est une narration linéaire ; mais, avec ma télécommande, regarder la télévision est devenu un art participatif : je puis désormais effectuer un redécoupage des films que je juge trop angoissants. Pour moi, LArme fatale est beaucoup plus agréable entrelardé dextraits des Nuits Blanches dIbiza et des Animaux du Monde.
Ces remarques nous amènent à parler de linstrument le plus puissant dont disposent les raconteurs dhistoires : la peur. Et pas seulement la peur, mais langoisse. Des trois formes de la peur, langoisse est la première et la plus forte : cest cette tension, cette attente qui naît quand on sait quil y a quelque chose à craindre mais quon na pas encore réussi à identifier lobjet de cette crainte ; cest la peur qui naît quand on saperçoit soudain que son épouse devrait être rentrée depuis une heure, quand on entend un bruit bizarre dans la chambre du petit dernier, quand on se rend compte quune fenêtre quon est certain davoir fermée est à présent ouverte, que les rideaux bougent, et quon est seul dans la maison.
La terreur, elle, nintervient quà linstant où lon voit ce dont on a peur : lintrus qui savance armé dun poignard, les phares de la voiture qui remonte lallée de la maison, les hommes du Ku Klux Klan qui sortent des buissons, lun deux une corde à la main. Cest linstant où tous les muscles du corps se crispent et se tétanisent, ou bien où lon se met à hurler, ou encore où lon senfuit. Il y a de la folie dans cet instant, une force paroxystique mais cest une force de déchaînement, pas de tension, et, de ce point de vue, la terreur, si éprouvante soit-elle, est préférable à linquiétude : enfin, on connaît au moins lapparence de ce que lon craint. On en connaît les limites, les dimensions. On sait à quoi sattendre.
Lhorreur est la plus faible des trois. Après que lévénement redouté sest produit, on en contemple les restes, les vestiges, le cadavre affreusement mutilé ; les émotions vont du dégoût à la compassion envers la victime, et même la pitié se teinte de révulsion et de répugnance ; on en vient à rejeter la scène et à nier toute lhumanité au corps quon nous montre ; par la répétition, lhorreur perd sa capacité à émouvoir, déshumanise jusquà un certaint point la victime, et, par conséquent, le spectateur. Comme lont appris les Sonderkommandos des camps de la mort, quand on a déplacé un certain nombre de cadavres nus, on na plus envie de pleurer ni de vomir : on fait le boulot, un point cest tout. On a cessé de les considérer comme des individus.
Cest pourquoi je mattriste de voir que tant dauteurs contemporains dhistoires dépouvante sintéressent presque exclusivement à lhorreur et délaissent linquiétude. Les films gore ne prennent plus la peine dinspirer au spectateur de la sympathie pour les personnages, ce qui est pourtant la clé pour le plonger dans linquiétude. Les scènes de terreur ne sont plus terrifiantes grâce à lempathie que lon ressent pour la victime, mais fascinantes parce que le public a envie de voir quelle méthode inventive de massacre le scénariste et le réalisateur ont mise au point. Oh, la victime transformée en chiche-kebab ! Ah, génial, le monstre qui fait jaillir les yeux du type de lintérieur !
Obsédés par le désir de filmer linfilmable, les réalisateurs dhorreur montrent linnommable au kilomètre et déshumanisent dans le même temps leur public en faisant de la souffrance humaine un « divertissement » soumis à une escalade obscène. Cest déjà grave, mais, à mon grand regret, trop décrivains de terreur font de même ; ils nont pas retenu la vraie leçon du succès de Stephen King : ce ne sont pas les passages gore qui font lefficacité de ses livres, cest la sympathie quil inspire au lecteur pour ses personnages avant le déclenchement des épisodes dhorreur, et ses meilleures uvres sont celles où, comme dans Dead Zone ou Le Fléau, lhorreur est relativement réduite. Ces récits baignent plutôt dans une inquiétude qui mène aux instants cathartiques de terreur et de souffrance, et, plus important, la douleur que vivent les personnages a un sens.
Cest tout lart de langoisse : faire si bien percevoir un personnage quon en vient à redouter ce quil redoute et pour les mêmes motifs que lui. Le lecteur ne reste pas extérieur à lui, à le regarder se faire recouvrir dune bave sanglante ou à contempler ses blessures béantes : il est aspiré à lintérieur, où il tremble à lavance de ce qui va se produire ou de ce qui risque de se passer. Nimporte qui peut débiter un cadavre en morceaux dans un roman ; seul un écrivain peut inspirer au lecteur le désir que le personnage survive.
Donc je nécris pas dhistoires dhorreur. Cest vrai, il arrive à mes personnages des évènements désagréables, voire terribles, mais je ne vous les montre pas en Technicolor. Je nen ai pas besoin et je nen ai pas envie parce que, pris par langoisse, vous imaginerez bien pire que tout ce que je pourrais inventer.
Orson Scott Card, introduction à LHomme transformé, récits dangoisse.
J'espère que la longueur du texte ne vous aura pas découragés, désolée, je voulais faire quelques coupes, mais je n'ai pas réussi à m'y résoudre.